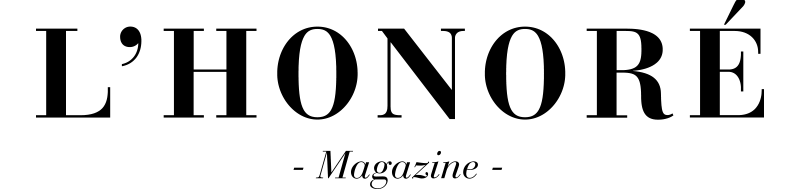Le repas gastronomique des français, figure du patrimoine immatériel de l’humanité, est l’héritage d’un savoir-faire ancestral et méconnu, qui s’est affiné au fur et à mesure de l’histoire.
Par Jean-Robert Pitte
(Suite et fin)
Si les invités ne sont pas trop nombreux, il est aussi possible de découper après présentation, sur un guéridon ou une desserte, les grosses pièces telles que gigot, dinde, rôti de bœuf, homard ou langouste. En revanche, les poissons en Bellevue se présentent entiers aux convives. Les desserts peuvent être disposés sur une desserte dès le début du repas. Leur raffinement décoratif est du meilleur effet. Cela se pratique encore aujourd’hui parfois avec les pièces montées de croquembouches lors des mariages. De grandes dessertes en marbre rouge, insérées dans les murs, sont encore visibles dans la salle à manger bleue de James de Rothschild au château de Ferrières (Seine-et-Marne) qui est redevenue une salle à manger de restaurant après quelques décennies de déshérence.
Les pratiques des restaurants ont beaucoup évolué depuis quelques années. Dans les auberges et les bistrots, l’usage a longtemps été de déposer les mets sur la table dans des plats de service, souvent ovales pour occuper moins de place, et de laisser les clients se servir eux-mêmes. Cela se pratique encore dans les maisons de tradition comme par exemple Lipp, la Coupole ou le Balzar à Paris. Seules les grosses pièces entières étaient découpées au guéridon, parfois chauffant et roulant, à couvercle d’argent, comme il en existe encore au Train Bleu, le mythique restaurant Belle Epoque de la Gare de Lyon. Dans les restaurants gastronomiques, les maîtres d’hôtel présentaient les plats aux convives, puis disposaient les mets sur une desserte dans une assiette avant de déposer celle-ci devant le client.

Aujourd’hui, les chefs ont de plus en plus pris l’habitude de servir chaque convive à l’assiette. Leurs ténors ont beaucoup voyagé et ont depuis longtemps été reçus avec générosité par leurs homologues japonais. Ils leur ont certes appris les bases de la cuisine française que ceux-ci ont parfaitement assimilée et interprètent avec talent chez eux ou en France où certains se sont installés. Les cuisiniers français, quant à eux, ont été fascinés par les règles culinaires et les présentations des mets au Japon. L’art de la découpe, les couleurs, la disposition dans des assiettes ou bols de toutes tailles et de toutes couleurs, les techniques de cuisson leur ont donné l’idée de s’en inspirer une fois de retour devant leurs fourneaux. Ils ont aussi acquis le goût du poisson cru, de la sauce de soja, du wasabi, du shisso, du yuzu, du macha, du bœuf wagyu, etc. Hélas, ils n’ont rien appris des aspects de la culture japonaise qui fondent ce style, en particulier les fondements religieux inspirés de la voie du Shinto et de celle de Bouddha, les principes esthétiques parmi lesquels la calligraphie et bien d’autres subtilités. Ils imitent donc, mais de manière si superficielle que c’en est souvent navrant et risible pour les Japonais. Ils mêlent, par exemple une dizaine d’ingrédients ou plus dans une recette, disposant mille pétales de fleurs, peluches d’herbes et brimborions divers à la pince à épiler, décorant des assiettes de balayures d’épices, de gouttelettes ou virgules de sauces multicolores, alors que dans la plupart des minuscules et délicats plats du kaiseki japonais, n’entre guère plus de trois composants. Ces chefs tiennent à signer leur assiette, laquelle prend tant de temps à composer que les clients attendent longtemps entre les plats. Du coup, le personnel de salle – qui n’a plus besoin d’être aussi compétent qu’hier, ni si nombreux – en est réduit à déposer les mets, parfois après avoir soulevé une cloche, en répétant longuement la liste de toutes les composantes. Les sommeliers s’arrachent les cheveux, car aucun vin n’accompagne avec harmonie ces cacophonies gustatives.
Les industriels et artisans des arts de la table, porcelainiers et orfèvres, s’en donnent depuis peu à cœur joie avec des réussites inégales. Les assiettes d’accueil sont souvent d’une folle imagination, celles du Jules Verne à la Tour Eiffel, par exemple. Des assiettes et écuelles de toutes formes, tailles, grains et couleurs leur succèdent. Les couverts sont parfois d’une préhension difficile, le pire étant atteint par les couteaux à viande trop souvent lourds et instables. Les verres sont devenus immenses, perchés sur des pieds comparables à des stilettos : ils permettent aux sommeliers de vider rapidement les bouteilles et de renouveler la commande, ce qui permet l’équilibre financier de l’établissement, compte tenu des coûts de personnel en France.

Heureusement, ces travers ne sont pas généralisés et ne sont que des effets de mode. Ils passeront et il suffit de choisir ses restaurants pour ne pas les subir. Il ne saurait être question de figer la cuisine française dans son style des années 1950, mais les chefs doivent comprendre qu’innover implique de posséder des bases solides – l’équivalent du solfège et de l’harmonie pour les compositeurs de musique -, de faire preuve d’humilité et surtout d’être animés du désir de faire plaisir. Brillat-Savarin l’a si bien dit : « Convier quelqu’un, c’est se charger de son bonheur tout le temps qu’il est sous notre toit ».