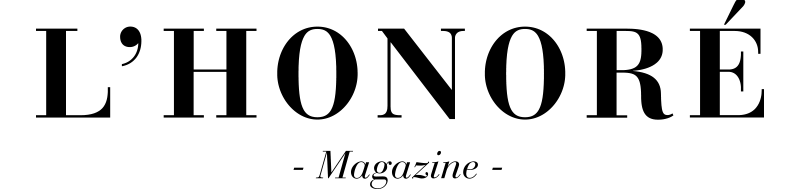Depuis des siècles, la truffe envoûte, inquiète, réjouit et questionne. Encore aujourd’hui, elle conserve jalousement nombre de secrets que nul ne sait percer, ce qui est sans doute mieux ainsi.
Par Serge Desazars
Que n’a-t-on déjà dit sur la truffe ! Depuis des siècles, sinon des millénaires, tour à tour elle envoûte, inquiète, réjouit ou questionne les hommes. Elle les fascine. Vrai qu’à ses valeurs gustatives exceptionnelles, elle ajoute une part de mystère qui, au fil des âges, a déconcerté tous ceux qui se sont penchés sur son cas : gastronomes, religieux, agronomes ou scientifiques. Aujourd’hui encore, elle conserve jalousement nombre de secrets que ni la science, ni les trufficulteurs eux-mêmes ne sont parvenus à percer.
L’usage de la truffe se perd dans la plus haute antiquité. Les savants de l’époque la croyaient « fille du tonnerre », car née de l’action conjuguée de tous les éléments : la terre, l’eau, et le feu de la foudre dont elle tire son aspect de boulet de charbon. Cet objet mystérieux au parfum si subtilement charnel, provenant du sous-sol, ne serait-il pas une créature du Malin, envoyée pour tenter les plus faibles ? Sa couleur noirâtre n’est-elle pas la marque de la noirceur de l’âme de ceux qui l’emploient ? D’ailleurs, n’appelle-t-on pas « ronds de sorcière » les cercles à la végétation rase et desséchée dans lesquels, aux pieds des arbres, elle prolifère ? Autant de pensées qui lui ont valu d’être bannie par l’Eglise pendant le Moyen-Âge.

A la fin du XIVe siècle, le duc Jean Ier de Berry, grand amateur de truffes, contribue au retour en grâce de la perle noire en la servant au banquet des épousailles de son neveu, le roi Charles VI, avec Isabeau de Bavière. Plus tard, un autre roi, François Ier, découvre la truffe dans des circonstances pour le moins surprenantes : lors de son emprisonnement en Espagne en 1525. Une fois libéré, il la fait connaître à la cour de France. De cette époque date une alliance qui ne s’est jamais démentie : celle de la truffe et des tables de souverains. En 1826, Brillat-Savarin lui donne le surnom de « diamant de la cuisine ». Pendant tout ce siècle, la truffe est alors aussi vitale à une grande table que les vins les plus fins, quitte à verser dans certains abus : ainsi, la dinde truffée devait-elle être fourrée de 500 grammes à 2,5 kg de truffes !
Viennent ensuite la Grande Guerre et l’accélération des mutations du monde rural. Décimée dans les tranchées, la paysannerie doit se recentrer sur des productions à fort rendement et abandonne l’entretien des espaces boisés qui fournissent d’excellentes truffières. Avec une production en berne et des perspectives sombres, les trufficulteurs sont condamnés à révolutionner leurs pratiques ou à disparaître à court terme.
La mise au point des plants truffiers, c’est à dire mycorhizés en laboratoire, permet la création d’une véritable agriculture de la truffe, avec ses truffières et ses méthodes de culture. En trois décennies, la profession se métamorphose. L’érosion des rendements est certes enrayée, mais la truffe reste rétive à toute production de masse et la science demeure impuissante à garantir une optimisation des récoltes. En définitive, si elle dépend désormais de l’homme pour son développement et sa production, cette petite boule rebelle tient en retour l’homme en son pouvoir et refuse de se donner facilement. Ne faut-il pas voir en cela une belle leçon d’humilité donnée à ceux qui n’aspirent qu’à façonner la planète à leurs besoins et tirer d’elle le maximum ?
La truffe, ou plutôt les truffes tant la famille est nombreuse, est un champignon souterrain. Elle est le produit d’un mycélium, réseau de filaments se développant dans le sol, entre les racines de certains arbres. Cet échange de bons procédés, ou cette symbiose, voit le mycélium pourvoir les racines de son acolyte en sels minéraux et en eau, tandis que l’arbre l’approvisionne en sucres. La truffe est difficile et peu d’essences – une quinzaine – trouvent grâce à ses yeux. C’est ainsi que l’on n’en trouve qu’aux pieds des charmes, des pins noirs d’Autriche, des noisetiers ou, bien sûr, des chênes. Mais l’arbre ne fait pas tout. La nature du sol est également déterminante, de même que, dans une moindre mesure, le climat. Un sol calcaire et des étés chauds et secs offrent les conditions idéales de son développement. Par conséquent, les régions de prédilection sont au sud de la Loire et, hors de France, en Espace, en Italie et en Australie.

S’il existe des dizaines de champignons souterrains biologiquement assimilables à des truffes, la reine est sans conteste la truffe noire, ou tuber melanosporum. Dite aussi truffe du Périgord ou mélano, elle livre des nuances de terre, de bois ou de musc. De taille variable, elle peut aller du petit pois à certaines récoltes exceptionnelles pouvant dépassant le kilo. Son péridium est franchement noir, recouvert de petites excroissances pyramidales, telles des diamants. La couleur de sa chair est d’un noir intense. Surtout, elle est parcourue d’un entrelacs de veinules blanches.
Née du mariage des dernières pluies printanières et des premières chaleurs, entre la fin avril et la fin juin, la truffe noire se développe lentement entre l’été et l’hiver, pour atteindre sa pleine maturité entre décembre et mars. C’est en fin de saison que la patience du trufficulteur est récompensée par de longues randonnées sous les branches constellées de feuilles séchées, en compagnie d’un chien au flair soigneusement éduqué. Il y a dans cette scène un quelque chose d’éternel, autant qu’une délicieuse ambiance de sérénité et de temps retrouvé. Pas après pas, le panier se remplit de boules terreuses, délicatement extraites du sol par une main experte et soucieuse de ne pas blesser la précieuse récolte. Chaque pépite est récoltée à maturité, sans risque d’erreur puisque les truffes trop jeunes ne dégagent aucun parfum et, par conséquent, demeurent tout à fait indétectables, même pour un champion de l’odorat. Il est également possible de s’intéresser au ballet des mouches qui virevoltent à la verticale de la truffe dans laquelle elles viennent de pondre, mais on imagine sans peine le caractère aléatoire, sinon fantaisiste, de cette méthode. L’emploi du cochon, unique préposé à la quête truffière au XIXe siècle, a été abandonnée : l’animal, gourmand et lourd, dégradait le mycélium en marchant et, souvent, avalait le champignon en le déterrant.