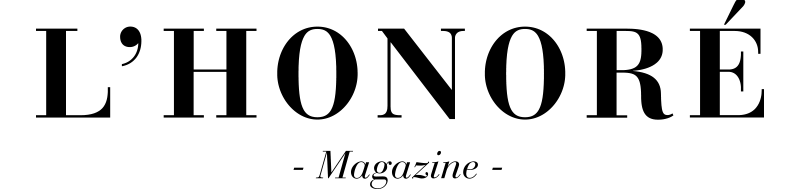Jamais en manque d’actualité, le chanteur français Roberto Alagna sera de retour sur la scène parisienne dès le printemps 2019, dans Carmen puis dans Otello. Considéré comme l’un des plus grands ténors au monde, il sort, cet automne, un disque inédit avec son épouse, la soprano polonaise Aleksandra Kurzak. Nous les avons rencontrés en exclusivité.
Par Romain Rivière
Trouvère cet été, La Traviata à l’automne, puis Otello et Carmen au printemps prochain… Etiez-vous en manque du public parisien ?
R. A. : J’ai toujours beaucoup chanté à Paris, mais il est vrai que j’ai fait une représentation de Trouvère cet été, et une représentation de La Traviata à l’occasion de la sortie du disque cet automne. C’était une idée d’Aleksandra, qui a proposé ce projet aux équipes de l’Opéra de Paris qui ont adoré le projet, et ont ajouté une représentation à cette occasion. C’était un challenge pour moi, puisque je n’avais pas chanté l’œuvre depuis 25 ans et ne pensais pas la rechanter un jour, et surtout un plaisir de la chanter avec Aleksandra.
A. K. : Nous avons en effet vécu une soirée extrêmement chaleureuse et mémorable. La séance de dédicaces s’est prolongée jusqu’à deux heures du matin, et nous a permis de mesurer l’amour et l’enthousiasme de ce public. Mais moi, de toutes façons, j’adore Paris. Ces dernières années, j’y ai chanté autant, voire davantage, que Roberto. J’adore ce public, autant que la scène, la chaleur et le professionnalisme des équipes, ou encore la direction… Je m’y sens chez moi.
Vous avez sorti, en novembre, un disque inédit de duos de Puccini : Puccini In Love. Etait-ce un projet d’artistes ou un projet de couple ?
R. A. : C’était les deux. L’idée est venue d’Alezsandra, qui rêvait de chanter une fois dans sa vie les duos de Madame Butterfly et de Tosca. Finalement, nous avons poussé le projet un peu plus loin en consacrant un disque entier à Puccini : beaucoup de disques de duos entre un ténor et une soprano ont été réalisés, mais jamais aucun ne lui a été consacré. C’est une première.
A. K. : C’était en effet un vieux rêve. Vocalement, cela a été très difficile en raison d’une orchestration très dense, mais la satisfaction d’avoir enregistré ce disque est immense.
R.A. : Il est vrai qu’avec Puccini, la difficulté est à la fois technique et émotionnelle. Ces grands airs dramatiques sont complets, exigeants, avec de grands phrasés et beaucoup d’aigus. Pour Aleksandra, qui n’avait presque jamais chanté Puccini, c’était un baptême du feu. Mais l’expérience s’est révélée positive et nous prévoyons, d’ici à quelques années, de chanter Tosca ensemble.

Le public parisien vous verra également ensemble dans Otello, au printemps…
R. A. : Absolument. Nous l’avons déjà chanté ensemble à Vienne et le redonnerons à Paris au printemps. C’est un vrai plaisir car Desdémonoe, qui est un personnage très délicat de l’œuvre et qu’on sous-estime souvent, est merveilleusement incarné par Alezsandra qui réussit le tour de force d’allier un tempérament, une musicalité, une douceur, une fragilité et une force qui en font un personnage très complet.
Vous avez souvent triomphé à Paris malgré des difficultés vocales. Ce public vous transcende-t-il ?
R. A. : J’ai la chance d’avoir un panache qui me pousse à toujours aller au bout des choses. J’aime l’idée qu’un artiste se donne entièrement, avec ses fragilités, et j’ai souvent mesuré combien ces expériences peuvent amener à découvrir de nouvelles émotions et de nouveaux partages avec le public. Il m’est ainsi arrivé, lors de la première de Carmen à Paris, d’être complètement aphone au point que je ne pensais pas pouvoir aller au bout de l’ouvrage. J’y suis pourtant allé, en trouvant grâce au mental d’autres possibilités, et je crois avoir chanté ce soir-là mon plus bel acte final de Carmen. Mais en réalité, les soucis liés à l’instrument vocal sont fréquents pour tous les chanteurs. Comme le disait Caruso : « je suis en forme deux soirs dans l’année, et ces soirs-là, je ne chante pas. » Les chanteurs ont l’habitude d’annuler quand ils ne sont pas en forme. Moi, j’ai beaucoup de mal à annuler.
On vous oppose souvent à Luciano Pavarotti, disparu il y a onze ans, en raison de votre carrière marquée par une grande prise de risques, un répertoire extrêmement large, un goût prononcé du spectacle, ou encore des incursions régulières en variété…
R. A. : J’ai toujours considéré que j’avais un instrument qui était fait pour être utilisé, sans distinction d’un genre à l’autre, et je ne considère pas avoir pris de risques considérables. Pas plus que Pavarotti, justement, qui est resté un ténor plein jusqu’au bout, et a gardé une voix parfaitement timbrée en toutes circonstances sans jamais s’économiser. Il avait également, à sa manière, un vrai talent de comédien. Il jouait comme un acteur de cinéma, comme Marlon Brando qui, lui non plus, ne bougeait pas beaucoup mais était bel et bien l’un des plus grands acteurs du monde. Pavarotti concentrait tout son jeu dans le visage et dans la voix : il n’y à qu’a voir son Lamento dans Tosca, avec son visage lumineux et son sourire subtil… C’était extraordinaire. Il a d’ailleurs réussi à nous faire oublier son embonpoint : n’est-ce pas la caractéristique d’un grand comédien ? Malgré tout ce qu’on a pu dire à son sujet, Pavarotti était le plus grand de tous les ténors et personne n’a su ni ne saura l’égaler.
A travers vos performances hors du répertoire lyrique, qui vous ont valu de nombreuses critiques, est-ce votre ambition de participer à la démocratisation de l’opéra ?
R. A. : Je n’ai jamais cherché cela. Quand je sors du répertoire lyrique, je le fais toujours dans une démarche artistique, musicale. Tous les chanteurs, ou presque, sont un jour ou l’autre sorti du répertoire lyrique. Ma différence avec la plupart d’entre eux, et même si ma voix reste toujours éduquée et bel cantiste, c’est que je cherche toujours à lui donner un style qui se rapproche des genres musicaux que j’interprète, en n’hésitant pas à m’affranchir des techniques du chant lyrique. On entend souvent des critiques à ce niveau-là, mais la vraie responsabilité incombe aux médias, notamment aux médias spécialisés qui ne connaissent pas véritablement notre métier ni notre instrument. On parle des puristes, mais les puristes, c’est le monstre du Loch Ness : il fait du bruit mais on ne le voit jamais, tout simplement parce qu’il n’existe pas. C’est une légende. On crée une rumeur qui s’étale dans les colonnes des journaux, mais finalement, personne dans le public ne m’a jamais reproché d’avoir chanté Luis Mariano ou encore Sicilien. Les plus grands amateurs d’opéra, qui ne sont pas si nombreux, s’en moquent car ce n’est pas leur sujet. Et s’ils écoutaient ces disques, il est probable qu’ils aimeraient. A la fin, la musique reste toujours ce qu’elle est fondamentalement : un divertissement.
Certains de vos pairs critiquent l’évolution de l’opéra qui, démocratisé, souffre d’une qualité médiocre de ses productions : mal chantées, mal mises en scène. Est-ce votre avis ?
A. K. : On a toujours dit que l’opéra était plus mal chanté que par le passé. Dès que c’est contemporain, on dit que c’est mauvais. Ce qui est vrai, c’est qu’autrefois, les chanteurs étaient au centre de l’œuvre et étaient plus libres, alors que ce sont désormais les metteurs en scène et les chefs d’orchestre qui commandent.
R. A. : Moi qui suis passionné avant d’être chanteur, je trouve qu’on chante globalement mieux qu’avant, mais qu’on chante avec le goût d’aujourd’hui. Dans le passé, les chanteurs se permettaient plus de choses : ils adaptaient, coupaient, transposaient, ajustaient leur voix. Aujourd’hui, nous devons nous plier aux exigences de la mise en scène et de la direction, qui ne prennent pas toujours en compte les contraintes et exigences de nos voix. Les fragilités des chanteurs ont tendance à être oubliées. Il nous arrive de donner une générale publique la veille d’une première : comment peut-on chanter à un tel niveau deux soirs de suite ? Corelli, qui reste l’un des plus grands Raul de l’histoire (dans Les Huguenots, ndlr), n’aurait jamais pu chanter l’œuvre en respectant tout à fait la partition originale. Quant à Kraus, il s’accordait toujours trois jours de pause entre les représentations : aujourd’hui, une telle exigence ne permettrait plus d’être engagé. Enfin, il faut reconnaître que certaines mises en scène actuelles, dans le décor, les accessoires ou encore le jeu entre les personnages, ne racontent plus vraiment l’histoire et cela peut être déstabilisant.