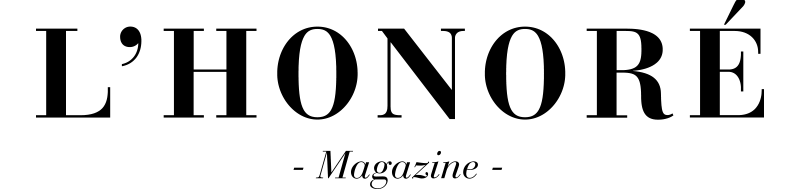Mondialement reconnu comme le plus grand ténor actuel, Jonas Kaufmann est revenu à Paris avec une double actualité française : son rôle dans Don Carlos, opéra français de Giuseppe Verdi, à l’Opéra Bastille ; et un disque, L’Opéra, entièrement consacré au répertoire français.
Par Tancrède Riviere
En septembre 2018, nous avons beaucoup entendu parler de Luciano Pavarotti, disparu il y a 10 ans. Êtes-vous sur le point de nous le faire oublier ?
(Rires). On ne peut pas oublier Pavarotti. C’était une voix en or. Il est difficile de parler de lui, parce que ses qualités étaient évidentes, mais aussi ses limites. Et je ne parle pas de son poids ! Ce n’est pas un musicien avec qui il était facile de travailler. Et son répertoire se limitait entièrement à l’opéra italien, ce qui est dommage. Mais il a été le meilleur.
Un répertoire limité, peu de talents de comédien… N’incarnez-vous pas le contraire ? Est-ce également l’opéra qui a changé depuis dix ou vingt ans ?
Oui, en partie. Mais il y a toujours eu des chanteurs qui présentaient bien, savaient jouer et étaient aimés pour cela. Corelli était un bel homme, et un vrai comédien, même si les critères du bon goût étaient différents. Le milieu a changé, parce que les goûts évoluent. Je raconte souvent l’histoire d’un directeur d’opéra, qui avait vu un jour une production à Vienne. Il s’en souvenait comme d’une perfection. Un jour, il est tombé sur une captation. En la regardant, il s’est dit : « Mais il n’y a rien à voir ! Tout le monde se tient là sans rien faire, personne ne se regarde ! À l’époque, je croyais que c’était le nec plus ultra, des chanteurs formidables, un grand chef… » Et c’était le cas… mais 30 ans auparavant. Nous voulons plus. Aujourd’hui, le problème est que nous manquons profondément d’imagination. Les gens ne lisent pas assez, ils aiment être divertis facilement. La télévision, le cinéma, les jeux vidéo sont des réalités virtuelles faciles à digérer. Lorsque vous allez à l’opéra ou au théâtre, tout est affaire d’illusion. C’est l’imagination qui travaille. Bien que nous luttions contre cela, nous avons dû progressivement nous rapprocher de la réalité, afin que les gens puissent sentir, souffrir ou se réjouir avec nous. C’est pourquoi nous voulions aussi des chanteurs qui correspondent physiquement aux rôles. Heureusement, nous en revenons, car on s’est aperçu que sans la qualité profonde des voix et de la musique, qu’importe l’apparence ?

Est-ce lié à l’évolution du rôle du metteur en scène ?
Oui. Cette fonction n’existait pas. Au siècle dernier, les chanteurs voyageaient avec leurs propres costumes. Lors des tournées, ils emportaient dans une grande valise leur tenue de Lohengrin, leur tenue de Pagliacci… Lohengrin ressemblait à Lohengrin, que fallait-il de plus ? Puis il a fallu que tout soit différent à chaque fois : l’époque, les personnages… Avec les DVD, on dispose de toutes les images des productions passées, et il s’agit de les concurrencer. Alors comment faire quelque chose de neuf ? La volonté de tout changer à n’importe quel prix est devenue un peu folle. Je me bats quelquefois avec les metteurs en scène, en leur disant : Vous pouvez faire ce que vous voulez, interpréter comme le vous le souhaitez, mais chaque élément doit avoir un sens. On ne peut pas commencer à se débarrasser de ceci ou cela au prétexte que ça n’entre plus dans l’interprétation. Si un personnage dit : « Que faites-vous agenouillé ? » et que personne n’est à genoux, ce n’est pas possible. Il faut trouver une raison pour qu’il soit à genoux. Certains le font brillamment, d’autres non. Je ne souhaite pas retourner au grand divertissement, dans lequel on ne peut pas tout donner vocalement parce qu’il y a trop d’autres impératifs.
Vous travaillez avec Krzysztof Warlikowski, qui peut apporter des idées fortes. Comment se passe la collaboration ?
Nous avons des échanges, bien sûr. Mais il est attentif, il n’est pas du genre à donner des ordres et attendre qu’on obéisse. Il est sans doute difficile de travailler avec moi parce que je ne suis pas timide : si je pense qu’il y a un problème, je le dis. Je ne veux pas attendre l’échec et ricaner ensuite en disant que je le savais depuis le début. Nous devons travailler ensemble.
Vous avez dit souhaiter que l’opéra redevienne un genre populaire…
Je constate que les gens parlent plus d’opéra qu’il y a 15 ans. Il me semble que les Trois Ténors y ont contribué : le disque du concert de Rome s’est énormément vendu, et pour beaucoup de gens il s’agissait de leur premier disque classique ! Ce seul événement a changé les choses pour longtemps. Il y a eu également l’effet Andrea Bocelli, aux Etats-Unis notamment : le public achetait des CD d’opéra grâce à lui. On sous-estime parfois le pouvoir qu’a un seul élément de changer beaucoup de choses.

Vos problèmes vocaux de l’an dernier ont-ils changé vos plans d’avenir ?
Oui et non. Il faudrait être fou pour ne pas en tirer les conséquences. Mais je sais que je n’ai pas fait d’erreur sur le plan vocal. Il y a peut-être eu trop de voyages. J’ai su tout de suite qu’il faudrait simplement du temps et que je devais attendre. J’étais impatient. J’ai aussi compris qu’en dépit de toutes les précautions, cela peut arriver. Mais il n’y aura pas de conséquences sur mon répertoire ou ma technique. Je vais peut-être seulement essayer de m’aménager davantage de pauses.
Si vous en avez le temps, que souhaiteriez-vous faire à Paris, en dehors de la musique ?
Il y a beaucoup de choses que j’ai faire à Paris. Je connais bien la ville, je me sens local. J’essaie toujours de voir des projets à Garnier, à Châtelet, au TCE… Mais Paris, pour moi, c’est sans doute les musées et la nourriture. J’adore les musées, Orsay notamment. Et la nourriture, c’est évident, même si je dois faire attention à cause de mon costume ! (Rires)