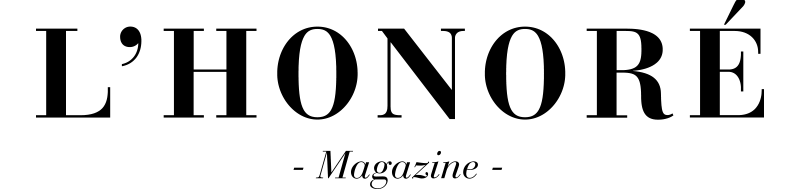Dans le nord de l’Equateur, à quelques kilomètres de la ligne imaginaire, on célèbre le solstice, version andine, l’Inti Raymi. Une fête impressionnante qui rappelle l’attachement de la population à ses origines incaïques.
Par Dominique de La Tour (texte et photos)
Le bruit a gagné la ville : dans la fontaine, baignade interdite. Nappe phréatique. Pollution. Pas d’ablutions rituelles pour les rites d’Inti Raymi – la fête solsticiale des Andes. Solstice d’hiver ou d’été ? Sur cet Equateur qui coupe la terre en deux à 22 km plus au sud d’ici, dur de trancher. Alors que le Pérou et tout l’hémisphère sud fêtent le rallongement des jours au 21 juin (oui : saisons inversées !), en Equateur, jour et nuit font 12 h toute l’année. Un symbole. Celui d’un temps égalitaire, perpétuel et parfait. Pas de bain sacré cette année ? Impensable.
La ville, c’est Otavalo. Dans la matinée, j’ai arpenté le marché artisanal. Tissages, objets en cuir, corne et résine : des étalages pour touristes, et même si des touristes, il y en a peu, pas l’insistance lourde façon Marrakech : ici, on est timide. C’est pourquoi les informations sont difficiles à pêcher. Et c’est pourquoi on se “lâche” pour Inti Raymi.

Pour les nuits courtes que je vais passer ici, je suis l’hôte de l’Otavalo : Nom facile à retenir ! Squattant la brique crue d’une belle demeure coloniale, ce boutique hotel est, dit-on, le plus agréable en ville. ll est au centre, en tout cas, et le personnel, de la réceptionniste au barman, fait des pieds et des mains pour collecter pour mon compte le bouche à oreille qui vole de rue en rue. Le portier me hèle comme un gamin qui court vers l’école : “¡ Hola Señor ! Pour le bain rituel, va à la cascade ; et demain, manque pas la cérémonie des coqs !” Pour cette fête éparpillée, tout se compose comme un puzzle. Mon 4X4 ne va pas chômer. Je fais le plein. Car à Inti Raymi, le pompiste prend ses congés.

En maraude, je parcours les villages-rues de la vallée que surplombent un volcan. Les musiciens patrouillent, tournant la ronde à intervalle, dans un sens, dans un autre, au rythme hypnotique des guitares novices, du violon et de la melodica – l’accordéon à bouche qu’alimente un long tube souple. Les mélodies sont répétitives, lancinantes. Ecoutez-les une fois : elles vous hantent toute la vie. Parfois, une famille retient le groupe, qui s’exhibe alors dans l’intimité sonore des maisons sans meubles, ou danse devant les plus petites. Ces mélodies attirent la faveur du nouvel an solaire, et pour cela, il y a un tarif : un poulet rôti dans son seau de patates – ou un pack de bière. La journée a été bonne : déjà nos artistes titubent.
Courte pause à l’hôtel. A tout hasard, je retourne à la fontaine. Des barrières d’acier confirment : la baignade est annulée. Mais des individus partent sur la gauche, par les ruelles, confirmant les dires du portier : ils vont à la cascade. En lignes, ils avancent, jouent, braillent, se défiant des automobilistes qui n’osent klaxonner. La nuit est épaisse. Dans des bouteilles d’eau formant vitre, des bougies chatouillent l’air ; des braseros fumottent dans l’air humide, des étals et leurs woks embrasés jettent des coup de chaud. Comme on dresse les croix sur les tableaux d’église, les femmes dressent les lourds “castillos” sur un échafaud. Ces “châteaux” sont le sapin de Noël du cru, triangles de bois chargés d’ananas, de bananes, de flasques de vin : des offrandes comme sur nos épicéas d’Europe, qu’initialement on décore pour obtenir les faveurs de l’année qui s’allonge. Un vieux souffle dans une corne spiralée, des femmes tournoient. Soudain, l’assaut : on se rue vers une maison qui a promis un repas. Pour tous !

Je piste les jeunes gens, gars aux tignasses infinies luisant comme des ailes de corbeau. S’aidant de frontales ou du Led de leur portable, ils éclairent la descente, en rythme, vers le flot du torrent. Longues baignades en caleçon sous les cascades froides. Puis on se rhabille et se réchauffe. On relance les mélopées sur les instruments trempés par les lourdes haleines de l’eau ; et puis, fier de leur exploit très physique, ils se replient, transis, vers le centre ville.
La nuit s’étire sur les derniers ballots du marché qui a plié bagage. La foule, par paquets tourne et retourne. Sous l’envoûtement des melodicas, des violons et des charangos, ces bouzoukis péruviens taillées dans des cougourdes. Des rondes de bonnets d’alpaga et de casquettes inversées. Des déguisements : Zorro, Ben Laden, des masques de Scream ou de clowns maléfiques. Un carnaval où chacun enfile son fantasme. Refrains. Naïfs. Paillards. On boit sec.
Le lendemain, j’arpente une kermesse des alentours. J’achète quelques babioles qui financeront les associations. Les vieux plaisantent avec moi, réclament des photos et prennent la pose en montrant leur meilleur profil incaïque. C’est bien dans ce village qu’on prépare pour cette nuit la version la plus intégriste d’Inti Raymi. L’idéologie marxisto-religieuse du Sentier Lumineux a contaminé toutes les Andes, et pratiquer cette religion est avant tout un signe de fierté face à l’ordre institué par la dure conquête espagnole. Pour Inti Raymi, la messe de la Saint-Jean récupère en tapinois la fête : ponchos neufs, gobelets de jelly verte et rose attendent en tremblotant les enfants.

Une passerelle sur la Panaméricaine : en dessous, dans un amphithéâtre de gazon, la fameuse “fête des coqs” déploie ses rites. La foule est immense. Coincées dans l’embouteillage, des centaines de voitures, ont pris le parti de regarder. Et je plonge dans la mêlée joyeuse des hommes qui portent à deux, sur des perches, des guirlandes de poulets encore vivants qui ballottent, comme des suppliciés du moyen-âge. Les femmes en costume se promènent, coq au poing, comme un faucon. Clair comme du cristal, l’aguardiente, est puisé dans des seaux et distribué à pleins gobelets.
Il se fait tard et je poursuis. Encore un peu plus en exil de la ville. A la faveur de la nuit, je me suis mêlé à la foule qui crache des haleines épaisses comme du chocolat froid. On piétine, toujours en musique. Tambour, kena (flûte), poutoutou (conque) : l’orchestration est celle des Incas. Enfin, nous descendons par un sentier en lacet. Des kilomètres dans le noir. Combien ? Je ne sais. Enfin, on bifurque à gauche, écrasant la broussaille : la foule déjà fait cercle comme pour un sabbat défendu. Le chamane est là, campé au bord de la source : un colosse en treillis de guérillero. Salués par le mugissement de la conque que fait retentir un sonneur. Les jeunes presque nus s’enfoncent dans l’eau, même quelques rares filles en soutien-gorge. Auparavant, sur chaque pèlerin, le chamane a soufflé un nuage comme un pulvérisateur… de l’eau ou de l’eau de vie ? Balayé par les faisceaux de mille portables comme pour un tir de DCA, l’air semble essorer les chants, les relents de gnôle, des premières rosées, des feux âcres que les enfants ont allumés pour un bivouac. Parlant quechua, la langue de leurs ancêtres Incas, ils tisonnent les braises qui chauffent les corps au milieu des herbes toutes crissantes de rosée.
Je repasse le lendemain. Pour l’acte final, comme celui d’une corrida. Les accoutrements sont plus restreints : hommes en pirates ou en pistoleros, avec chapeaux noirs à pyramide et sur-pantalons en peau de lama ; femmes en robes blanches de tradition andine, et parfois avec les Stetson, vestons à franges des cow girls. C’est la partie la plus impressionnante des festivités. Au signal des fifres de bois, les hommes se mettent marche, de front, en bottes, en rangs, comme une armée du XVIIIe que des serre-files animent à coups de fouets. Pas une seule femme. La poussière est suffocante, Même les plus machos relèvent le foulard jusqu’au nez. A chaque pause, une voix dominatrice édicte : les étrangers et les femmes n’ont pas leur place dans la procession ! En revanche, des centaines de garçonnets sont dans le cortège, copiant leurs aînés en fouettant les traînards. Je marcherai longtemps encore avant d’atteindre la place centrale. Celle de Cotacachi – le bourg voisin célèbre pour son cuir. La police attend. En tenue anti-émeute. Une médaille de la sainte Vierge complète parfois la protection.

Soudain, par une rue opposée, une autre foule déboule. Un village rival. La place est envahie par les rangs d’hommes, galvanisés par les kilomètres de marche au pas de charge. Tout le monde vocifère. Les forces de l’ordre contiennent cette mer toute en force et en rage. Soudain, deux chefs de clans ennemis s’aperçoivent. La police se fige. Les deux compères s’approchent avec défiance puis se touchent la main dans un sourire entendu : cette année, il n’y aura pas de rixes. Il n’y aura pas de mort. Les célébrations d’Inti Raymi ont lieu entre le 18 et le 24 juin de chaque année.