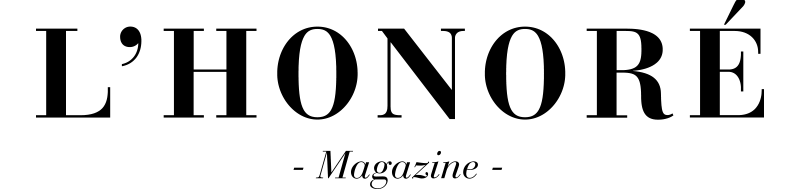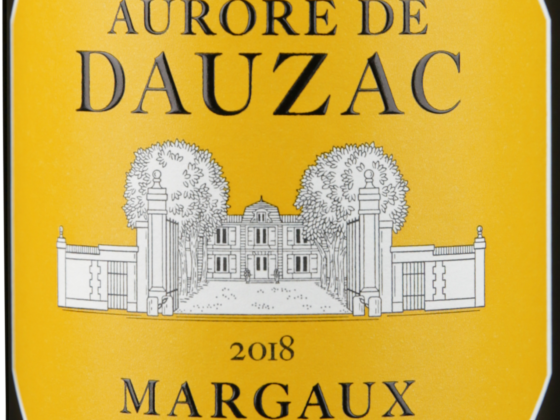Ex-république soviétique, négligée quand elle n’a pas sale réputation, la Biélorussie s’attarde dans son passé, mais pas que soviétique, offrant, entre autres, l’occasion insolite de dormir dans de vrais châteaux.
Par Dominique de la Tour
Un aéroport moderne, aux halls clairs, une policière affable : on n’a pas cette image de la Biélorussie. Du reste, la Biélorussie a-t-elle une image ? Qui citerait à la seconde Minsk en capitale ? Chagall né à Vitebsk ? De Gaulle prisonnier en 1916, à Chtchoutchin, dans l’ouest ? Un gars jovial me remet mon 4X4. Dès le parking, me voici cerné par le paysage biélorusse moyen : la forêt. La moitié du territoire est couverte de sapins, de bouleaux, de mousses aux senteurs de russule.

Et elle ? Sait-on qu’elle coule ici ? La proverbiale Bérézina – la “Rivière des Bouleaux” – paresse à 40 km des pistes d’atterrissage. J’y fais un saut. Le GPS est flou mais ma carte est bonne : entre les bicoques écaillées de Borissov et les camions éructant leurs humeurs noires, je trouve l’accès aux marécages. Des poules d’eau trillent. Une vieille barque fait tinter sa chaîne. En face, sur le banc de roseaux, un héron engloutit une perche frétillante. Deux stèles bilingues : c’est ici qu’en 1812, par -40 degrés, les sapeurs Hollandais du général Eblé ont planté dans la fange leurs ponts de pilotis. Ils mourront gelés, au grand complet, mais en permettant à la Grande Armée encerclée de s’échapper par l’autre rive, dans le grognement déçu des boulets russes. Un riverain accourt avec sa caisse vermoulue, où dansent boutons régimentaires, boucles d’équipement, balles et clous de souliers. “Frantsouz ?” Il me propose ces reliques, sous l’oeil d’une épouse qui, derrière son carreau sale, veille à ce qu’il ne fasse aucun rabais…

Sur la route de Minsk, la baïonnette géante de 39 mètres d’acier se voit de loin : c’est la butte du Slavy Kurgan, “tertre de la Gloire” qui célèbre le tribut terrible payé par les Biélorusses contre Hitler. Mais au pied du monument, les gamins n’ont cure de cette “Grande Guerre patriotique” ressassée par les livres : ils font le cochon pendu sur le canon d’un char T34, garé ici en souvenir.
J’atteints les larges perspectives de la capitale la plus “soviétostalgique” d’Europe. Surplombant les méandres flemmards de la rivière Svislotch, ses palais à colonnades se font face, piquetés de statues d’ingénieurs et de kolkhoziennes, coiffés d’étoiles rouges, tamponnés comme un passeport de faucilles et de marteaux. La chute du communisme a glissé comme sur le caoutchouc d’un vieil imper. Il y a eu juste ce subit engouement pour la messe, ses cantiques sombres, ses montées de cire jaune et d’encens embrumant les icônes. A la douzaine, on a rebâti toutes les églises, telles qu’au XVIIIe.

D’ailleurs, ma première nuit sera au Monastirsky. Sans gros effort linguistique, ce nom me souffle que l’hôtel fut un jour monastère : couloirs dallés de tuile, murs de chaux, canapés 1960 des cellules devenues suites confortables. La cuisine est savoureuse mais rustique. Le service plus avenant que stylé : un Parador version slave, qui se sent tenu à un zeste d’austérité par égard aux moines qu’on y cloîtrait jadis.
Le coeur de Minsk ne boude pas pour si peu bars et brasseries “tendance” où une jeunesse blonde rêve de Rome ou de Londres, mais lâche son mojito pour une ronde paysanne dès qu’un musicien à chemise brodée tire sur l’accordéon.
cap à l’ouest : des lacs, des champs vallonnés…
Laissant les deux ziggurats staliniens de la Porte de Minsk, je mets cap à l’ouest. Des lacs, des champs vallonnés comme les plis d’une cape où picorent, par centaines, des cigognes. Les maisonnettes en bois s’espacent, jaunes, vertes, bleues, avec leurs enclos de bois grisé par l’hiver et les étés extrêmes. Sur un pont d’autoroute, une pancarte immanquable suggère une visite étrange : Dzerjinskovo. C’est le domaine où a grandi Feliks Dzerjinski, hobereau polonais rallié aux bolcheviks pour fonder l’impitoyable Tchéka – l’ancêtre du KGB.
Rasée jusqu’à 20 cm du sol, la maison natale sommeille dans les haleines humides de pin et de genièvre. Une matrone m’ouvre le musée, commentant pieusement les tableaux, les photos de famille, le guéridon où le cruel Feliks prenait le thé. Je remercie poliment. Et continue vers l’ouest, à travers ce pays décidément plein de curiosités.

Je compte pousser jusqu’à Brest. Brest-Litovsk disait-on quand c’était le grand-duché de Lituanie : dans l’immense forteresse de brique vérolée par les obus de 1941, les Bolcheviks ont signé avec les Allemands la paix de 1917. Le centre ville est mignon avec ses rues piétonnières où rit une foule jeune qui alterne entre tavernes et terrasses. Dans la forêt de Brest, peut-être verrais-je les derniers bisons d’Europe, même s’ils se montrent surtout l’hiver, quand la paresse les pousse vers des mangeoires garnies par l’homme.

Ce soir m’attend un hôtel unique. Niasvij s’enroule dans l’écharpe d’émeraude de ses douves où nasillent les colverts. Les bastions protègent un palais Renaissance. L’entrée à fronton, un porche élégant avec clocher à bulbes. J’apprécie les lignes de fuite de sa cour en éventail, vrai décor de théâtre où, justement, une équipe russe tourne un film à costumes.
Une femme à voix chantante me tend la clef. Un escalier de marbre, des corridors aux dalles séculaires donnent à mon pas un écho seigneurial. Cette porte immense est celle ma chambre. Un long couloir et son armoire ventrue comme si j’avais dix francs et vingt habits à brandebourgs à ranger. Ma baignoire prend ses aises dans une tour, avec vue sur les fossés. Je m’étends sur le lit. A baldaquin, bien sûr. Au mur, peints à l’huile, de grands seigneurs et dames me regardent. Jérôme Bonaparte dormit ici, mais ce sont des princes lituaniens qui firent l’histoire du lieu, les Radziwill. Le restaurant a ce côté simple et généreux des pavillons de chasse, servant le rafraîchissant khlodnik – délice de betteraves au vinaigre de pomme et à la crème – ou du caviar rouge sur des crêpes de pomme de terre – les sacro-saints draniki – car sachez qu’un repas biélorusse ne peut se faire sans crêpes.

Niasvij ne sera pas le seul lieu irréel où je dormirai. A 30 km à peine au nord clapote ce petit lac, où vingt nonnes en blanc jettent des cailloux, sous le regard indulgent de deux abbés. Un château fort y mire les marqueteries de pierre et de brique de ses cinq tours. Une place d’armes au puits en fer forgé s’entoure de chemins de ronde aux marches hautes, et d’un labyrinthe de salles gothiques. C’est le château de Mir et c’est un hôtel, lui aussi.
Il est tard. Les touristes sont partis, mais la lourde porte de chêne reste ouverte. Un gardien à lampe torche est en sentinelle. Je lui annonce que je veux sortir pour flâner le long de l’étang. “Mais bien sûr, seigneur : la nuit, le château est à vous”. C’est un peu ce que je ressens : j’erre dans les étages aux vitraux de plomb, aux caissons enluminés, puis je descend souper dans la cave aux voûtes amples et aux serveurs discrets, avec cette impression d’être le maître de céans.